À l’ère de l’Anthropocène, le Design graphique peut-il et doit-il adopter une posture éthique ?
À ne pas confondre avec la morale qui renvoie à un corps constitué de normes, l’éthique implique un questionnement sur la norme elle-même. On peut dire de l’éthique qu’elle « renvoie à ces devoirs que l’on a envers soi-même et envers autrui, mais qui ne sont pas dictés par des lois. Comment agir bien sans savoir ce qui est bien ? Le but de l’éthique est justement de définir ce qui est bien à partir d’une réflexion sur les effets de nos actes. » L’éthique nous amène à des questions telles que : qu’est-ce qui est le plus important dans la vie ? Que voulons-nous accomplir ? Quels types de rapports voulons-nous entretenir avec les autres ? On peut se demander s’il serait bénéfique d’inclure l’éthique comme une boussole pour mieux guider les pratiques du Design graphique face aux problématiques de notre temps. Quelle serait alors une éthique du Design graphique ?

Design et Anthropocène
Le XXIe siècle est merveilleux. En pleine crise climatique due à notre économie néo-libérale, le CO2 atteint un niveau qui, la dernière fois qu’il a été connu était il y a environ 2 millions d’années. Bienvenue dans l’époque géologique de l’Anthropocène ! Elle caractérise l’avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et ayant une incidence globale significative sur l’écosystème. L’extinction de masse des espèces est alarmante et soulève des questions quant à notre propre survie. Vandana Shiva déclare : « La croyance en une planète morte a déclenché des processus qui deviennent une menace réelle pour la vie sur Terre. (…) Nous avons construit une vision du monde anthropocentrique de la suprématie humaine, affirmant (…) que nous pouvons être possesseur du vivant (…) Nous avons oublié la vie et le vivant. »

Il ne faut pas oublier que le design fait partie du domaine des arts appliqués à l’industrie, « [C’]est un élément fondamental d’un système socio-économique postmoderne, inextricablement lié aux notions enracinées de capitalisme et de consommation ostentatoire. » Le design a accompagné la révolution industrielle au XIXe siècle où la société à dominante agraire et artisanale est devenue une société commerciale et industrielle.
D’après Alain Findelli « La fin ou le but du design est d’améliorer ou au moins de maintenir l’habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. » La situation actuelle nous appelle à changer radicalement nos modes de vie. Des remises en question de nos habitudes sont nécessaires, notamment en termes de communication. Remarquons que les problèmes étudiés par le design actuellement n’auront plus aucun sens dans un monde non-viable. Le design doit s’éloigner des impératifs du marché et des contraintes qu’il impose, vers des approches plus responsables.

La responsabilité, un chemin vers l’éthique ?
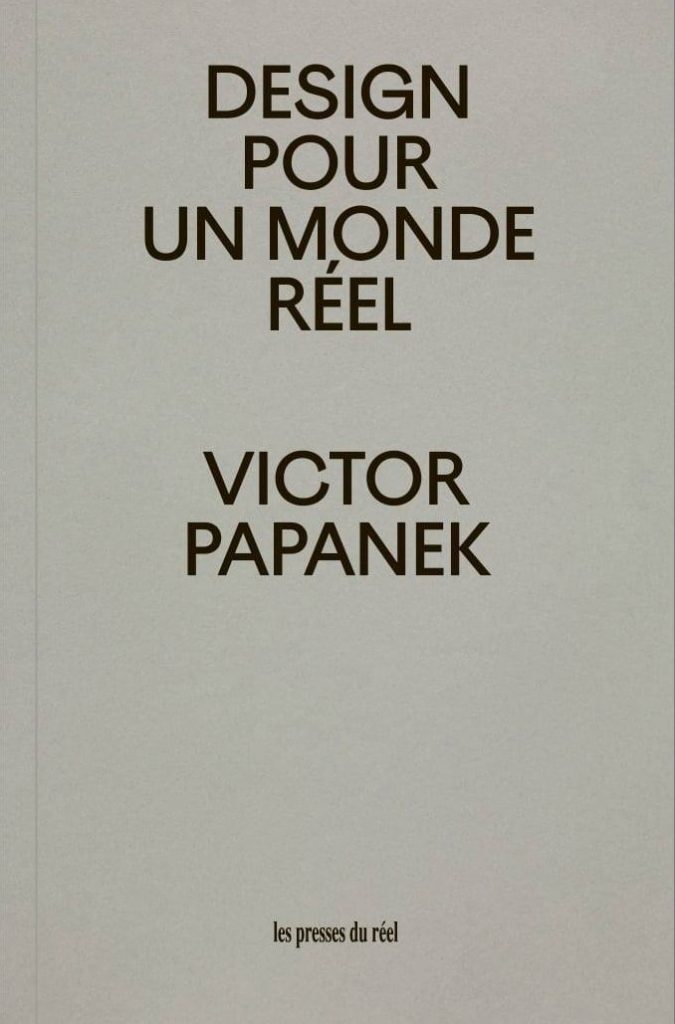
Victor Papanek est l’un des premiers penseurs de l’éco-design. Il publie en 1971 l’ouvrage précurseur Design for the real world dans lequel il milite pour l’inclusion des problématiques sociales, environnementales et des enjeux de durabilité dans les démarches de conception. D’après lui « Au siècle de la production de masse, où tout doit être planifié et étudié, le design est devenu un outil à modeler les outils qui permet à l’homme de transformer son environnement et, par extension, la société et sa propre personne. Cela exige de la part du designer un sens aigu des responsabilités morales et sociales. » À l’heure actuelle, ses réflexions se révèlent être plus pertinentes que jamais.
Être responsable c’est être en capacité de répondre de ces actes. À l’inverse, l’irresponsabilité est le fait de ne pas assumer, de ne pas envisager les conséquences. On peut se demander si la circonstance ne découle pas d’une forme d’irresponsabilité individuelle et collective. Nous pouvons pointer du doigt le capitalisme et les multinationales pour leurs fonctionnements néfastes. Cependant il faut admettre qu’il existe un accord collectif consistant à leur déléguer notre responsabilité. Sortir d’une posture passive qui considère que les autres ou le futur vont solutionner les problèmes de l’humanité permettrait de se mettre en action pour accompagner le mouvement du changement.

Pour revenir aux idées de Victor Papanek, il affirme que le designer est responsable de l’impact de son produit sur le marché. Mais plus encore, d’après lui le discernement du designer devrait s’exercer bien avant c’est-à-dire : est-ce que son design contribue ou non au bien-être social ? Il y a une différence entre ce dont les hommes ont besoin et ce dont les entreprises ont besoin. Un design éthique répondrait aux vrais besoins des hommes en harmonie avec le vivant et non à l’économie, car notre responsabilité ne s’étend pas seulement à autrui (les hommes) mais plus largement : au vivant. Savoir ressentir notre responsabilité, celle-ci nourrie par notre raison et nos sentiments, pourrait nous mener vers l’éthique.
Une éthique du design graphique
L’éthique est entrée dans le débat principalement dans le domaine du design produit avec la montée de l’éco-conception. On peut prendre pour exemple les enseignes de commerce autosuffisante ou encore Fairphone. Mais qu’en est-il du design graphique ? En France, l’association Designer Éthiques a produit le documentaire Ethics for Design et organise chaque année l’événement Ethics by Design. À travers des ateliers et conférences, designers et chercheurs explorent le sujet de la conception responsable et durable du numérique.
Aux États-Unis le débat de l’éthique dans le design et le numérique est porté par des personnes comme Tristan Harris qui a lancé un appel à minimiser les distractions et à respecter l’attention des utilisateurs. Pour lui, la technologie est devenue « une économie de l’extraction de l’attention », « une course pour pirater nos instincts». Dans un environnement saturé d’informations, le bruit médiatique nous submerge. Il est partout : affiches, télévisions, journaux, enseignes, panneaux publicitaires, sites internet, vidéos, etc. Cette pollution visuelle et mentale prend une place excessive, ainsi en plus de manipuler elle abolit tout espace de pensée et de jugement. Yves Citton, théoricien de la littérature et chercheur, explique que l’économie de l’attention pourrait même être le nouvel horizon du capitalisme. La question de la raison d’être de nos créations doit alors se poser. Le message que l’on veut faire passer justifie-t-il l’attention des personnes ?

L’éthique du design graphique nécessiterait la modération à une juste mesure. Pour cela, elle exige une prise en compte plus globale de la complexité des systèmes qui l’entourent, de voir au-delà du culte de l’image produite. Intégrer une compréhension de toutes les entités en harmonie : vivant, écologie, contexte, etc. et comprendre l’arrière-plan politique, économique et social dans lequel intervient le travail du designer. En effet, son impact est à considérer largement. Dans son blog, Mike Monteiro explique que « Nous devons craindre les conséquences de notre travail plus que nous n’aimons l’intelligence de nos idées. » La valeur du travail du designer graphique devrait être jugée à son impact plutôt qu’à son esthétique. Le design graphique a pour mission de rendre « beau », autrement dit, il rend désirable. Ceci dit, nous avons réalisé que la situation critique dans laquelle nous sommes est en partie due aux désirs artificiellement inculqués. L’activité nuisible du design graphique doit se transformer afin de répondre aux besoins éprouvés des personnes. « Comment imaginer des concepts allant à l’encontre d’un principe économique totalitaire en demeurant soi-même dépendant de ce même principe ? »

Nous devons sortir des règles du jeu en agissant sur les moyens, car ils ne sont pas neutres. Le collectif Formes Vives présente cette idée dans leurs Hypothèses de travail. D’après eux, « Le graphisme, (…) doit se défaire de son orgueil rationaliste, objectiviste, aveugle et glacial, il doit en découdre avec cet insupportable oxymore qu’est la communication efficace. Se détourner des idées d’efficacité et de justesse c’est enfin faire confiance à l’image pour ce qu’elle peut être et donc c’est faire confiance au spectateur, lui rendre sa liberté de traducteur. » Les mots sont forts, ne plus s’adresser à des spectateurs mais à des traducteurs. Voilà une considération plus éthique de la communication. Ils ajoutent : « Leur rendre leur liberté c’est les encourager à y répondre et surtout c’est ne jamais chercher à y répondre à leur place. » Plutôt que de concevoir une image dans le but qu’elle produise l’effet attendu, un graphisme éthique s’adresse à l’imaginaire et à la puissance critique des traducteurs. Ne pas dicter ce qui doit être pensé mais encourager l’émancipation de chacun. « Parce que [la médiatrice ou le médiateur] n’est ni au-dessus, ni en dehors de la communauté mais l’égal des hommes et des femmes auxquel·le·s il ou elle s’adresse, sa traduction est légitime dès lors qu’elle est explicitement subjective et qu’elle se tient à distance suffisante pour que se dessine librement, dans l’espace laissé vacant, celle de son interlocuteur. »

Les propositions d’un design graphique éthique seraient opportunes dans cette phase de bouleversement. Il doit contribuer à façonner les récits et aspirations futurs avec des démarches nouvelles. Un exemple pertinent est celui de Terra Forma : manuel de cartographies potentielles. Cet ouvrage propose de découvrir la terre autrement en étendant le vocabulaire cartographique traditionnel. Un de ces auteurs, Frédérique Aït indique qu’en « temps de régime climatique critique, on a besoin absolument de nouvelles images, de nouvelles représentations pour pouvoir agir autrement. »

L’urgence nous oblige à quitter notre attitude léthargique (pourtant si confortable) face à la question environnementale. Bien plus qu’un choix, l’adoption d’une posture éthique est un devoir. S’il faut prendre nos responsabilités et agir, ce n’est pas parce que nous sommes des spécialistes de la communication, mais parce que nous sommes des humains. Rien n’est plus puissant que le devoir de protéger la vie. Il est impératif de réenchanter les esprits à travers un imaginaire nouveau, de repousser les limites et les murs de nos récits. Redéfinissons le design graphique comme « une discipline vivante et exploratrice de la vie » qui cultive l’émergence d’une dimension critique du regard, produit de l’espace pour l’intelligence, mobilise et nourrit l’imaginaire de chacun. Ce sont ces imaginaires qui vont nous guider vers un monde plus désirable. Un design graphique éthique encourage l’émancipation de ses traducteurs, il leur demande :
« Que vois-tu ? Qu’en pense-tu ? Qu’en fais tu ? »